-
Deux ans plus tôt. Un coin d'herbe et deux camarades de fac.
A cette époque, je gaspillais mon temps et mon énergie à simuler l'étudiante en Arts. Un rôle qui m'allait assez mal.
J'ai détesté la fac à l'instant même où j'y traînais les pieds et trébuchais, laissant s'écrouler dans ma chute tous mes idéaux édulcorés de ce que pouvait être ou ressembler la vie étudiante.
Malgré ces désillusions, j'y retournais deux ans plus tard après avoir simulé l'infirmière. De simulation en simulation, j'aurais pu finir comédienne, mais il n'en est rien.
Toujours est-il que ce jour-là pour le déjeuner, je me mêlais à ces deux camarades, avec qui je partageais un sourire de circonstances et deux-trois feuilles de cours tout au plus. Histoire d'avoir l'air normale.
L'une d'elles, voix de crécelle et clope au bec, partageait son enthousiasme pour Mullholand Drive que je n'avais jamais eu l'occasion de voir.Cette grande gigue, devenue presque invisible derrière son épais brouillard, vantait le caractère mystique de l'oeuvre Lynchéenne et de son attrait pour les films tellement cool qu'on y comprend rien (sic).
Malgré le dégoût que m'inspirait le personnage caricatural qui m'adressait ses conseils avisés de cinéphile hors-pair, une certaine curiosité pressante naquit à cet instant précis.
J'ai toujours repensé à ce déjeuner avec une certaine frustration.
C'est là, qu'hier, ma vie allait prendre un tournant capital : Lynch dans la télé (acheter un dévédé, mais non voyons). Jubilation. Tu vas voir gourdasse, si j'y comprends rien.La femme brune se fait renverser et se réfugie dans un appart. Une blonde débarque à Hollywood et la découvre dans la salle de bains. Une autre femme s'appelle Coco. Un blondinet tue trois personnes et un autre type crache un espresso visiblement infect. La brune se fait appeler Rita, comme Rita Hayworth sur l'affiche, puis avoue finalement à la gentille blonde qu'en réalité elle ne se souvient de rien.
Et moi non plus à vrai dire. Rien, hormis quelques bribes d'un rêve où des ballons de baudruche flottaient dans l'inondation d'une grande baraque où un milliers d'enfants venait patauger.
Le truc con, c'est que le médoc que j'ai pris pour soigner cette putain de crève m'a tellement assomée, que je me suis littéralement effondrée de sommeil. Au tout début de l'intrigue.Le projet Mulholland Drive est tombé à l'eau.Moi aussi, par ailleurs.Si on veut. votre commentaire
votre commentaire
-
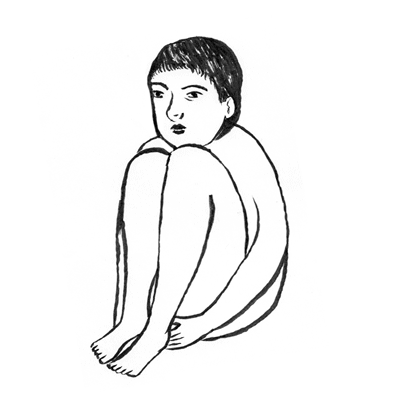
Dans une vie antérieure (comprenez le cruel passage de l'adolescence), je faisais partie de la catégorie numéro deux : les moches.
Parce que dans la jungle du collège, c'était ça. Et j'imagine que ça l'est toujours : les populaires, les moches et l'entre-deux qui sert à rien. Cet enfer ne dure pas éternellement, Dieu merci.
Les binocles qui mangent le visage, la ferraille dans la bouche, l'acné récidiviste, le cheveu luisant et la couenne tenace. Moche ultime. Type agression visuelle.
Et puis arrive le lycée et les rôles s'inversent : la connasse populaire rase désormais les murs. Et les moches deviennent beaux (pas tous, hein). C'est la loi de la balance karmique.
Alors voilà, la monstruosité du collège ne s'en est pas trop mal sortie, finalement. Elle a fait du chemin depuis le retrait définitif de l'instrument de torture buccal et de l'avènement des lentilles de contact. Alleluia.
On prend vite goût à tester sa nouvelle séduction, ça regonfle un (tout petit) peu la confiance en soi, foutrement malmenée à force d'entendre des horreurs à son sujet.
Aujourd'hui, je pointerais volontiers du doigt tous ces ex-beaux (Merci, Facebook), mais on en restera là. La vie ne les a déjà pas épargnés, n'en rajoutons pas.
Tout ça pour dire que tout espoir n'est pas perdu. Ou presque. Jusqu'à il y a une semaine, où le drame s'est avéré.
Obnubilée par la symbolique du je-commence-une-nouvelle-phase, qui consiste à changer d'état d'esprit en même temps que de culotte, de garde robe, de disposition des meubles et de tête, je décidais d'en venir à bout de cette houpette du diable qui cachait mon front, pour une nouvelle coupe dégotée dans un de ces foutus magazines pour écervelée avertie dont je devrais stopper net toute lecture.
Le rituel du coiffeur est intimement associé à cette phase de reconstrution du moi extérieur (en profondeur, je reste toujours aussi con, c'est pas compris dans le kit). Une fois par an, donc, je régénère ma tignasse qui pourrait pousser dans le droit chemin si je ne la menaçais pas tous les mois à coup de ciseaux hystériques. Complexité du genre féminin.
Voilà que je piétine, supplie, puis oblige le garçon patient et masochiste qui partage ma vie, à m'accompagner au Temple de la Reconstruction du Moi : le salon de coiffure.
Argh, je la vois, elle est là. Ciseaux en main. Le sourire narquoit. Elle sait. Je le sens.
Elle sait qu'elle va ruiner ma vie en même temps que mon portefeuille. L'espace d'un instant, mes pieds indiquent la marche arrière mais je fonce comme un bélier borné que je suis, la boule au ventre, sans réfléchir. Je cours à ma perte.
La voilà avec les même ciseaux au dessus de ma tête. A l'intérieur (de ma tête), ça hurle d'injures (envers moi-même) mais je me dis que, quoiqu'il advienne, les cheveux ça repousse, et que les chouchous, les cagoules et les barrettes c'est pas fait pour les chiens.
J'ouvre l'oeil et j'aperçois une silhouette dans le miroir qui me fait face : une fille aux cheveux hyperlissés, hyperdégradés, hyperfrangés qui me regarde. Sa tête ne va pas du tout, mais alors pas du tout, avec le reste. Un blague vivante. Je pense que j'aimerais ne pas être elle.
Trop tard.
Le même garçon, très patient et soucieux de rester en vie, qui partage la mienne (de vie), me complimente et je pleure intérieurement parce qu'une fois l'effet hypercoiffé dissipé, je vais retrouver une chevelure digne de la forêt amazonienne, le truc visuellement hyperfoisonnant qui te donne l'allure d'un Popples électrocuté.
Parce que, Madame Ciseaux-là, elle a fait du grand n'importe quoi : je ne suis pas coiffeuse, certes, mais j'ai appris la géométrie à l'école et question symétrie, elle a du avoir la gastro le jour de la leçon.
Oui, ça repousse. OUI. Il y a des choses plus graves dans la vie que de ne plus ressembler à rien.
Je crois que l'an prochain je vais songer à changer de cervelle. Autant neutraliser le mal à la source.
(crédits illustration : Rachel Levit)
 1 commentaire
1 commentaire
-
A l'origine de tout, je cherchais une jupe. Noire, un peu longue et évasée achetée chez H&M il y a quelques mois et jamais encore portée (sauf lors des cérémonies nostalgiques ultraprivées du type jupequitourne, mais j'en ai trop dit).
En fait, en ce moment, j'aime ça, les jupes. Il s'agit d'un sevrage progressif de l'éternel duo jean-converse que l'on pointe d'un regard accusateur depuis que j'ai mis le pied dans ce que l'on appelle communément la vie active de merde.
Bref. Je me souvenais de l'avoir prêtée (la jupe) à mon géniteur féminin pour une cérémonie quelconque. Sauf que depuis, il me semble ne l'avoir plus jamais vue cotoyer les autres colocataires de ma penderie.
La mère niant un prêt à long terme et prouvant son innocence en dépouillant la sienne (de penderie), j'ai donc passé la soirée d'hier dans la cave, à écumer carton après carton. Il me fallait cette foutue jupe coûte que coûte, question de vie ou de mort. Elle ne pouvait se trouver que là. A copiner entre vieux chiffons.
Tout est passablement trié : les fringues à revendre sur eBay, celles dont j'ai décrété qu'elles ont dépassé la date de séjour dans l'armoire mais que je garde au cas où dans trois mois j'ai changé d'avis, celles qui passent de l'armoire au carton déguisements (amis du bon goût, bonjour). Il y a bien trois catégories pour une dizaine de cartons. Donc quand je dis que j'y ait passé la soirée, c'est pas du mensonge, c'est de la réalité moderne.
Je nageais un peu enragée dans cette mare aux bouts de tissus, lorsque mon oeil a dérivé sur une boite à chaussures contenant mille et un papier en vrac. C'est là que j'ai retrouvé l'url de ce vieux blog pourri que j'ai pour ainsi dire oublié depuis que j'ai changé de chemin, de maison et accessoirement de vie.
Coucou, donc.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Cet après-midi-là, j'ai voulu fuir de tout. Fuir la vie, loin.
Comme un irrépressible besoin d'aller s'isoler hors du temps. Là-haut, précisément sur cette colline. Celle qui surplombe la ville de mon enfance, je me souviens que la vue y est magnifique.
Une bâtisse abandonnée trône sur le cimetière du village attenant, l'atmosphère y est presque étrange, surnaturelle. Le bruit du vent et c'est tout.
Cet après-midi-là, on apercevait un incendie autour duquel dansaient trois canadaires. Je me concentrais sur l'épaisse fumée qui venait noircir la clarté du ciel, comme pour empêcher mes démons de surgir.
C'est la première fois que je venais ici, seule. Avant, c'était avec Lui. Juchés sur cette hauteur, la nuit tombante face aux lumières de la ville, tous phares éteints.
Les rares passants croyaient qu'on s'échangeaient nos fluides à la manière des ados dans les films américains. Une fois, on nous a même pris en photo et ça nous a étranglés de rire d'imaginer leur tête face à l'immortalité de deux paumés s'empiffrant de junk food, quand ils croyaient au scoop porno de l'année.
C'était notre rituel alimentaire de décompression. Avant que tout ne vole en éclats.
C'est là que Jo est arrivé. La cinquantaine peut-être, le visage marqué par le temps. Il s'est approché lentement en demandant si ça allait, sentant clairement cette douleur que j'essayais de dissimuler. Il a certainement cru que j'allais me jeter dans le vide.
Il a dit des mots justes, sans connaître rien de moi, ni de mon histoire. Je crois même qu'il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit que ressentir ce genre de chose était merveilleux, parce que la passion est un sentiment extraordinaire même si l'on souffre à un moment donné. Et que c'est une réelle chance que de la vivre quand d'autres ne la connaîtront jamais.
Avant de partir, Il m'a serrée contre lui en glissant quelques mots de Brel dans les oreilles.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Il avait fini par l’appeler. Comme il n’avait plus de nouvelles et qu’il mourait d’envie de la revoir. Après avoir imaginé mille choses à son sujet, ses doigts avaient devancé sa raison et pianoté le numéro de cette fille qui l’intriguait, sans qu’il eut le temps de réfléchir à ce qu’il allait bien pouvoir lui dire.
Ce soir, la lune baigne la ville d’une lueur pâle et il fait froid. Dans son anorak, il attend que vingt et une heures sonnent, il fait les cent pas. Il ne veut plus penser de peur de s’interroger sur des détails sans intérêt qui viendraient troubler son enthousiasme.Dans quelques instants, elle paraîtra sur le pas de la porte. Sa baraque est immense, pense-t-il en donnant des coups de pieds nonchalants dans le gravillon qui jouxte le pavillon de banlieue.Dans l’obscurité de cette nuit d’automne, on aperçoit le feu rouge d’une cigarette. Il est anxieux, regarde sa montre. Il distingue difficilement les aiguilles. Vingt-et-une heure sont passées.Il n'a même pas entendu les pas foulés de sa belle sur le sol qu’il fait grincer depuis un bon moment. Elle s'approche et sourit, il ne peut pas le voir dans les ténèbres mais il le devine. Il s’étouffe entre deux bouffées du mégot qui finira par mourir sur le sol sous ses gros godillots.Il aurait aimé au moins un Bonsoir, mais elle reste muette. Ils sont là, enveloppés par une nuit glacée, sans ne distinguer que leurs deux silhouettes.Ils n’ont rien à se dire, le silence qui pèse est plus éloquent que les mots. Elle avance, il la suit. Des nuages passent sur l’astre de nuit, on y voit plus rien du tout. Il la sent grelotter et l’entoure de son écharpe. votre commentaire
votre commentaire





